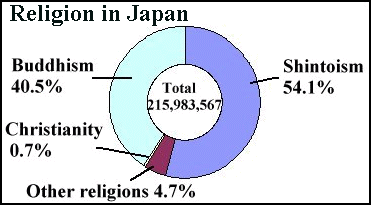
Le total est presque le double de celui des Japonais
population parce que certains Japonais
reconnaître plus d'une religion Le Japon n'est pas intrinsèquement un pays très religieux. Les pratiques religieuses sont souvent considérées comme des devoirs, des traditions et des coutumes plutôt que comme des choses ayant une signification spirituelle pour les personnes qui les pratiquent. Comme les Chinois, les Japonais vénèrent à la fois les divinités bouddhistes et folkloriques ainsi que les esprits de leurs ancêtres dans l'espoir de pacifier tout le monde et d'assurer ainsi le bien commun.Le confucianisme (une philosophie intégrant le culte des ancêtres) a été incorporé dans le code social et éthique du Japon.
Le shintoïsme, qui signifie "la voie des dieux", est une religion animiste informelle, qui vénère la nature, honore les ancêtres, rend hommage aux "kamis", ou esprits, et entretient traditionnellement des liens étroits avec l'État, l'empereur et la culture japonaise. Il existe littéralement des millions de kamis, dont la plupart sont associés au ciel ou à des objets naturels sur terre, tels que les arbres et les montagnes.La plus importante des divinités est Amaterasu-omikami, la déesse du soleil, qui, selon la légende, est un ancêtre de l'empereur japonais.
La plupart des Japonais pratiquent une forme ou une autre de bouddhisme et de shintoïsme, mais peu d'entre eux sont de fervents adeptes de l'un ou l'autre de ces cultes. Selon un décompte, le shintoïsme compte 107 millions d'adeptes (85 % de la population) et le bouddhisme environ 93 millions d'adeptes (75 %).
Il y a environ 1,7 million de chrétiens (environ 1½ pour cent de la population) qui se répartissent plus ou moins également entre catholiques et protestants. Il y a également de nombreux cultes religieux. Beaucoup ont des liens avec le bouddhisme et certains comptent plusieurs millions de membres. Il y a très peu de musulmans.
Liens sur ce site web : RELIGION AU JAPON Factsanddetails.com/Japan ; SHINTO Factsanddetails.com/Japan ; SHRINES, PRIESTS, RITUELS ET COUTOMES DU SHINTO Factsanddetails.com/Japan ;BUDDHISME AU JAPON Factsanddetails.com/Japan ; DIEUX, TEMPLES ET MONKS BOUDDHISTES AU JAPON Factsanddetails.com/Japan ; ZEN ET AUTRES SECTS BOUDDHISTES AU JAPON Factsanddetails.com/Japan
Bons sites web et sources : ;Livre : Religion in Japan cambridge.org ; Religion and Secular Japan japanesestudies.org.uk ; U.S. State Department 2020 Report on Religious Freedom in Japan state.gov/wp-content/uploads/2021/05/240282-JAPAN-2020-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf ; Resources for East Asian Language and Thought acmuller.net ; Society for the Study of Japanese Religions ssjr.unc.edu ;ContemporaryDocuments sur la religion japonaise kokugakuin.ac.jp
L'histoire de la religion au Japon est un long processus d'influence mutuelle entre les traditions religieuses. Contrairement à l'Europe, où le christianisme a submergé les traditions païennes locales, la religion indigène Shinto a continué à faire partie de la vie des gens depuis les premiers jours d'un État japonais organisé jusqu'à l'époque moderne. Lorsque le bouddhisme a été introduit au Japon au 6ème siècle, le ShintoLes croyances shintoïstes et bouddhistes ont commencé à interagir, ce qui constitue la caractéristique essentielle de la religion japonaise. L'exemple le plus frappant de cette interaction est la théorie du honji suijaku, selon laquelle les kami shintoïstes étaient considérés comme les incarnations des divinités bouddhistes. [Source : Web-Japan, ministère des Affaires étrangères, Japon].
Le confucianisme et le taoïsme sont deux autres "importations" religieuses qui ont joué un rôle important dans la société japonaise sur une période de plus de 1 000 ans. Les préceptes confucéens ont eu une influence majeure sur la philosophie éthique et politique japonaise au cours de la période de formation de l'État japonais (du 6e au 9e siècle), puis à nouveau au cours de la période Edo (1603 - 1868). Plus difficile à retracer que celle du confucianisme, l'influence du taoïsme sur la société japonaise a été considérable.L'influence du taoïsme religieux au Japon se retrouve dans l'utilisation du calendrier chinois et dans les croyances populaires telles que celles concernant la cartomancie et les directions de bon augure. déesse), Tsukuyomi no Mikoto (dieu de la lune) et Susanoo no Mikoto (dieu des tempêtes).
La plupart des Japonais ne se considèrent pas comme religieux mais se rendent néanmoins régulièrement dans des lieux de culte. Certains suggèrent que l'appréciation des changements de saison par les Japonais est enracinée dans la religion et que leur expérience des catastrophes naturelles les a rendus admiratifs des pouvoirs de la nature. Certains disent également que les Japonais pressentent l'existence de nombreux dieux et partagent intrinsèquement les croyances bouddhistes sur les thèmes suivantsle néant et la renaissance.
De nombreux foyers japonais possèdent deux autels : l'un shintoïste et l'autre bouddhiste. Les fidèles font des offrandes quotidiennes de gâteaux de riz, de sel et d'eau bénite qui sont déposés sur les autels, souvent décorés des photos des proches décédés. Un dicton dit que les Japonais viennent au monde en tant que Shinto et en sortent en tant que bouddhistes : les funérailles sont généralement célébrées selon les rites bouddhistes, tandis que les naissances et les mariages sont célébrés selon les rites bouddhistes.célébrée par des cérémonies shintoïstes.
Le culte des ancêtres décédés et les notions de yin et de yang, de magie spirituelle, de divination et de forces naturelles telles que le ki sont également présents au Japon. Ils ont évolué à partir des croyances taoïstes et confucéennes qui sont nées en Chine et ont pénétré au Japon à partir de la Corée il y a plus de 1 000 ans et peut-être dès le Ve siècle de notre ère.
Le spécialiste des religions G. Bownas a écrit : "Les sentiments religieux du Japon ont été principalement ceux de l'amour et de la crainte. Le but de l'observance religieuse était de louer et de remercier, et donc d'assurer la continuité de la bienveillance des pouvoirs, tout autant que de calmer et d'apaiser si la colère transformait cette bénignité normale en malveillance."
Après la restauration Meiji, la religion organisée a été divisée en trois catégories : bouddhiste, chrétienne et shintoïste. Il existe actuellement plus de 200 000 organisations religieuses au Japon, dont la plupart sont affiliées au bouddhisme ou au shintoïsme. Selon une enquête réalisée en 2000, les Japonais dépensent en moyenne 165 dollars par an pour des activités religieuses.
Livres : "Religions of Japan in Practice", édité par George J. Tanabe Jr. (Princeton University Press, 1999) ; "A History of Japanese Religion" édité par Kazuo Kasahara (Kosei Publishing) ;

Prier dans un sanctuaire shintoïste De nombreux Japonais accomplissent religieusement des rites bouddhistes et shintoïstes et rendent hommage à leurs ancêtres, mais ne se considèrent pas comme religieux. Une enquête a révélé que si moins d'un tiers des Japonais se disent religieux, plus de 80 % prient un kami shintoïste ou une figure bouddhiste au moins une fois par an.
Au Japon, la religion tend à être davantage une question de cohésion sociale ou de "sentiment que la vie d'une personne ne lui appartient pas" qu'une question de foi personnelle. Dans le cas du shintoïsme en particulier, de nombreuses choses restent vagues et indéfinies, sans code moral strict à suivre.
Le rituel et la religion sont menés par considération pour les forces cosmiques, presque comme une forme de politesse. L'érudite Satsuki Kawano a écrit dans son livre "Ritual Practice in Modern Japan" : "On s'incline devant les kami et les ancêtres pour des raisons similaires à celles de la vie quotidienne : saluer, montrer du respect, remercier, demander une faveur". Et le nettoyage, comme l'inclinaison, est un acte rempli de signification morale. Puisque le nettoyagen'est pas simplement pratiquée par souci d'hygiène mais est considérée comme un moyen d'améliorer le moi intérieur, elle constitue une forme de discipline morale."
La plupart des Japonais pratiquent une forme ou une autre de bouddhisme et de shintoïsme, une religion de culte de la nature propre au Japon, mais peu d'entre eux sont de fervents adeptes de l'une ou l'autre de ces religions. Selon un recensement, le shintoïsme compte 107 millions d'adeptes (85 % de la population) et le bouddhisme environ 93 millions d'adeptes (75 %).
Selon le ministère japonais des Affaires étrangères : "L'urbanisation a coupé de nombreux Japonais de leurs liens familiaux avec un temple bouddhiste et un sanctuaire shintoïste spécifiques. Pourtant, de nombreuses personnes se considèrent à la fois shintoïstes et bouddhistes. Les statistiques de l'Agence des affaires culturelles pour 2006 montrent que les membres combinés des deux religions sont environ 196 millions, soit environ 53 % de plus que le total de la population japonaise.Dans les sentiments religieux de la plupart des Japonais, le shinto et le bouddhisme coexistent pacifiquement plutôt qu'ils ne s'opposent. [Source : Web-Japan, ministère des Affaires étrangères, Japon].
"Pour la personne moyenne, cependant, l'affiliation religieuse ne se traduit pas par un culte ou une fréquentation régulière. La plupart des gens visitent les sanctuaires et les temples dans le cadre d'événements annuels et de rituels spéciaux marquant les passages de la vie. Ces événements annuels comprennent les festivals des sanctuaires et des temples, la première visite du sanctuaire ou du temple de la nouvelle année ("hatsumode"), et une visite du tombeau familial pendant le festival Bon.Les rituels commémorant les étapes de la vie d'un individu comprennent la première visite au sanctuaire d'un nouveau-né ("miyamairi"), la visite au sanctuaire du festival Shichi-go-san des garçons de trois et cinq ans et des filles de trois et sept ans, une cérémonie de mariage shinto et des funérailles bouddhistes.
Le shintoïsme est une religion locale issue de croyances animistes et chamanistes indigènes qui existent depuis des siècles. Le bouddhisme a été introduit de l'étranger et s'est répandu au Japon à partir de la Corée au sixième siècle de notre ère. Pour les Japonais, les différentes religions ne sont pas considérées comme exclusives les unes des autres et coexistent côte à côte depuis des siècles.
Pour les Japonais, le shintoïsme se préoccupe davantage de l'ici et du maintenant, tandis que le bouddhisme est davantage associé à l'au-delà. Un dicton dit que les Japonais viennent au monde en tant que shintos et en sortent en tant que bouddhistes. Les funérailles sont généralement célébrées selon les rites bouddhistes, tandis que les naissances et les mariages font l'objet de cérémonies shintoïstes. La plupart des foyers ont deux autels : un sanctuaire shintoïste pour les étagères ("kamidana") et un autel pour Bouddha.Les fidèles font des offrandes quotidiennes de gâteaux de riz, de sel et d'eau bénite qui sont déposés sur les autels. Les autels bouddhistes sont généralement ornés de photos de parents décédés.
À propos de l'acceptation du bouddhisme et du shintoïsme, un prince impérial a écrit au Xe siècle : "Les dieux et les esprits sont justes et équitables, car ils n'acceptent que la piété religieuse d'un homme. Allez les prier avec la sincérité du cœur et vous serez sûr de leur plaire."
Même si de nombreux Japonais ont des autels bouddhistes et shintoïstes chez eux, se marient dans un sanctuaire ou une église et achètent des tombes dans des temples bouddhistes, peu d'entre eux se considèrent comme religieux. La religion au Japon est souvent considérée en termes de culture, de tradition et de devoir plutôt qu'en termes de foi, de salut personnel et de croyances profondément ancrées. La visite des temples et des sanctuaires est considérée comme une activité récréative.des activités pour les vacances ou quelque chose que l'on fait pour avoir de la chance.
Une enquête réalisée par le Yomiuri Shimbun en 2005 a révélé que 72 % des Japonais n'ont pas d'affiliation religieuse spécifique et que seuls 25 % d'entre eux ont déclaré croire en la religion, 20 % ont déclaré pratiquer une foi et 37 % ont déclaré que la religion était importante pour vivre une vie heureuse.
L'une des raisons pour lesquelles les Japonais n'ont pas d'association particulière avec une religion donnée est qu'au cours de la période Meiji, la religion était tolérée tant qu'elle ne perturbait pas les réformes politiques et que la définition de la religion était façonnée par la définition occidentale de la "religion", qui ne faisait pas nécessairement de place aux croyances japonaises indigènes.Le shintoïsme d'État a été renoncé (voir Shintoïsme).
Le spécialiste des religions Tetsuo Yamaori a déclaré au Daily Yomiuri : "Depuis plus de 100 ans, nous avons identifié notre propre foi dans le cadre des religions monothéistes, et nous en sommes venus à penser que notre propre religion est primitive et moins importante que les autres.sophistiquée et ce n'est pas ce qu'une religion devrait être."
Le romancier japonais Haruki Murakami a écrit : "Dieu n'existe que dans l'esprit des gens. Surtout au Japon, Dieu a toujours été une sorte de concept flexible. Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre. Douglas MacArthur a ordonné à l'empereur divin de cesser d'être un Dieu, ce qu'il a fait, en prononçant un discours disant qu'il n'était qu'une personne ordinaire."
Certains ont dit que les statistiques mentionnées ci-dessus ne signifient pas nécessairement que les Japonais sont irréligieux, mais simplement qu'ils ne suivent pas des croyances spécifiques comme le font les adeptes des religions monothéistes. L'enquête du Yomiuri Shimbun de 2005 a également révélé que 56 % des Japonais croyaient au surnaturel, que beaucoup recherchaient une aide divine en cas de problème et que 94 % respectaient leurs ancêtres décédés. En 2008,Selon la police, 98,2 millions de personnes ont visité un sanctuaire ou un temple au cours des trois premiers jours de l'année, soit le nombre le plus élevé depuis 1974.
Mark Mullins, sociologue à l'université de Sophia, a déclaré au Daily Yomiuri : "Si l'on considère la dimension cognitive de la religion, où l'on se concentre sur la croyance, il semble que les Japonais soient plutôt moins religieux que, disons, les Américains. Mais si l'on considère le comportement rituel et la participation, tout à coup, la population est en fait assez religieuse. On pourrait dire que certaines pratiques ne sont qu'une coutume, que...peut-être, mais ils vont dans un lieu sacré."
Il y a environ 1,7 million de chrétiens au Japon (environ 1,2 million de protestants et un demi-million de catholiques), qui représentent environ 1,5 % de la population, contre 49 % en Corée. Le christianisme a traditionnellement trouvé ses adeptes parmi une petite minorité très instruite. Il n'a jamais réussi à s'imposer auprès des masses.
Environ 300 000 musulmans vivent au Japon, dont environ 50 000 sont japonais. La plupart vivent dans la région de Tokyo. L'islam n'a été reconnu comme religion officielle qu'en 1939. Une grande mosquée se trouve dans le quartier Yoyogi Uehara de Tokyo. Elle a été inaugurée en 2000, en remplacement d'une autre mosquée construite en 1937 et jugée structurellement dangereuse en 1985.
Les Japonais considèrent le confucianisme comme un code de préceptes moraux plutôt que comme une religion. Introduit au Japon au début du sixième siècle, le confucianisme a eu un grand impact sur la pensée et le comportement des Japonais, mais son influence a décliné depuis la Seconde Guerre mondiale.
Sources des images : 1) MIT Visualizing Cultures ; 2) Ray Kinnane ; 3,4) 5), Japan-Photo.de, 6) Tokyo National Museum
Sources du texte : New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Daily Yomiuri, Times of London, Japan National Tourist Organization (JNTO), National Geographic, The New Yorker, Time, Newsweek, Reuters, AP, Guides Lonely Planet, Compton's Encyclopedia et divers livres et autres publications.